Les 26 et 27 juin derniers, avait lieu, à l’Institut du Cancer de Montpellier (ICM), un congrès à destination des soignants dont le thème était :
“La place de la médecine intégrative en oncologie”
Je m’y suis rendu pour le compte de la Fondation Hippocrate.
Bien m’en a pris. J’y ai rencontré une très belle équipe de thérapeutes, soudée et enthousiaste, heureuse de partager les premiers fruits d’une expérience réussie.
Nous traversons une époque où les mauvaises nouvelles ne manquent pas. Mais il n’est pas interdit de dire ce qui va.
Les deux journées de conférences et de débats ont été organisées par le Dr Jibba Amraoui, médecin Anesthésiste-réanimateur, et toute son équipe.
Je ne vais pas ici reprendre l’ensemble des thématiques médicales qui ont été présentées à l’occasion de ces deux jours très riches en contenu.
J’aurai sûrement l’occasion, dans de prochaines newsletters, de couvrir plus en profondeur certains des sujets abordés à Montpellier.
Voici, en attendant, quelques-unes des grandes idées que j’ai retenues.
L’oncologie à la pointe de la médecine intégrative
Discipline relativement nouvelle, l’oncologie s’appuie sur des interventions médicales potentiellement lourdes.
Qu’il s’agisse de la radiothérapie, de la chimiothérapie, de l’hormonothérapie ou même de la chirurgie, les patients ont souvent à subir des effets secondaires.
Cela peut être de l’angoisse, de la fatigue, des douleurs musculaires ou encore des nausées.
L’approche intégrative permet d’accompagner ces problèmes de santé et d’apporter du mieux-être au patient.
Parfois, ces thérapies permettent au patient d’endurer davantage de soins lourds.
Si l’approche intégrative commence à s’imposer au sein de certains hôpitaux, c’est qu’elle donne des résultats.
Ces derniers peuvent être objectivés à travers des études.
Souvent, ils sont également constatés par les soignants et les patients qui s’en trouvent particulièrement satisfaits.
L’hypnose, une technique plébiscitée par de nombreux patients
C’est ainsi que le Dr Fabienne Roelants, oncologue au sein de l’Hôpital Saint-Luc à Bruxelles, rapporte qu’une patiente, à peine sortie d’une intervention chirurgicale vécue sous hypnose, explique que c’est l’un des plus beaux jours de sa vie.
J’aurais peut-être trouvé cette anecdote difficile à croire si Fabienne Roelants n’avait pas partagé avec l’audience quelques vidéos de ces séances d’hypnose pratiquées en salle d’opération.
Et, en effet, à travers ces images, on voit qu’il se passe quelque chose de spécial dans ces salles d’opération.
On voit les patients traverser l’épreuve du bloc en douceur. Ils sont sous hypnose, mais ils sont conscients de ce qu’ils vivent, conscients de l’intensité du moment.
Cette attitude des patients est parfaitement expliquée par Audrey Vanhaudenhuyse, neuropsychologue à l’hôpital de Liège, qui rappelle que personne ne peut être hypnotisé contre son gré.
Elle redonne à l’audience la définition médicale suivante de l’hypnose :
“État de conscience impliquant une attention focalisée ainsi qu’une diminution de la conscience périphérique, caractérisée par une augmentation de la capacité à répondre aux suggestions.”
Elle rappelle que l’on n’est pas hypnotisé, mais que l’on se met soi-même sous hypnose.
Elle précise également que tout le monde en est capable, même si, d’une personne à l’autre, cette aptitude est plus ou moins développée.
Il existe des virtuoses de l’hypnose pour qui l’exercice est naturel.
Mais avec un peu d’entraînement et d’accompagnement, tous les patients peuvent accéder à cette thérapie.
L’auto-hypnose : quand le patient devient son propre thérapeute
Le côté actif des patients se comprend encore mieux lorsque l’on écoute le Dr Jérôme Schweitzer, anesthésiste-réanimateur au GHM de Grenoble.
Lors du congrès, il a présenté le bilan d’une expérience qu’il a menée au sein de son hôpital avec des patients touchés par différents cancers.
Il a formé des groupes de 4 à 6 patients qui ont suivi 6 séances d’une heure et demie, espacées d’environ 10 jours, où ils ont appris l’auto-hypnose.
Cette technique, apprise par le patient, lui donne la capacité d’agir sur son corps et sa psyché.
Il dispose à tout moment d’un outil grâce auquel il peut notamment :
- réduire une douleur ;
- retrouver de l’énergie ;
- faciliter son sommeil ;
- calmer une crise d’angoisse ;
- prolonger les bénéfices d’une séance d’hypnose prodiguée par un thérapeute.
Cet accompagnement en groupe a permis au Dr Jérôme Schweitzer de suivre beaucoup plus de patients en moins de temps.
Mais ces rencontres groupées ont également aidé les patients à trouver du courage, du soutien et une écoute auprès de leurs compagnons d’infortune.
Un département dédié aux soins de support à l’ICM
À Montpellier, la mise en place d’une approche intégrative pour accompagner le cancer, notamment via les soins de support, existe depuis un certain temps.
Mais chaque médecin faisait cela dans son coin de l’hôpital.
Ils ont réussi à réunir leurs forces et à convaincre leur direction de la nécessité de créer un service dédié aux soins de support.
Le Dr Héloïse Lecornu, spécialisée dans les soins de support, s’est chargée de présenter ce nouveau service de l’ICM.
Elle explique ainsi que tous ces soins peuvent être prodigués au sein d’un même lieu et sous une même direction, ce qui facilite la coopération entre soignants ainsi que le parcours de soin des malades.
En France, les autorités de santé reconnaissent 9 disciplines ou domaines de santé comme faisant partie des soins de support en oncologie :
- la psychologie ;
- la nutrition ;
- l’accompagnement de la douleur ;
- l’accompagnement familial et social ;
- l’activité physique adaptée ;
- les troubles de la sexualité ;
- les conseils en hygiène de vie ;
- la préservation de la fertilité ;
- l’aide psychologique aux proches.
Les soins de support apportés aux malades et à leur entourage sont donc acceptables dès lors qu’ils entrent dans ce cadre.
Héloïse Lecornu a montré de manière très concrète, slides à l’appui, comment toutes les données du patient sont entrées dans le logiciel informatique de l’hôpital.
En effet, les soignants prennent le temps de remplir un questionnaire avec les patients et d’analyser de manière globale leurs besoins.
Ils obtiennent ainsi des informations biologiques, physiologiques ou encore sur le mode de vie des patients.
Et, en fonction de toutes les réponses qui auront été apportées, un parcours personnalisé est proposé au patient.
Les approches thérapeutiques accessibles à l’ICM
Dans le cadre de ces soins de support, l’ICM de Montpellier peut proposer à ses patients de nombreuses approches thérapeutiques. Ces soins de support sont pris en charge par la Sécurité sociale et les mutuelles.
Ainsi, les patients peuvent par exemple bénéficier d’un accompagnement au niveau de la respiration.
Le Dr Jibba Amraoui, médecin anesthésiste-réanimateur, a présenté des données récentes sur l’efficacité de ces exercices, notamment sur le stress et l’anxiété que les patients peuvent ressentir.
Elle a elle-même contribué à publier de nombreuses études scientifiques dans ce domaine.
L’ICM propose également des séances d’acupuncture, du yoga, de l’activité physique adaptée au patient, et de la musicothérapie.
Un accompagnement nutritionnel est aussi proposé.
Quel est le niveau de preuve scientifique requis pour qu’une thérapie puisse faire son entrée à l’hôpital ?
Lors du congrès de Montpellier, il y a eu de nombreux échanges sur les niveaux de preuve permettant de démontrer l’efficacité de toutes ces techniques.
La science n’est pas homogène dans ce domaine.
La méditation, par exemple, est très documentée, comme l’ont montré le Dr Claire Brami, cancérologue, et le Pr Tran, pédiatre au CHU de Nîmes.
Certains orateurs réclament davantage de preuves tangibles, comme des études randomisées en double aveugle.
La musicothérapie et l’art-thérapie commencent à être étudiées.
Mais les patients apprécient particulièrement ces temps de bien-être, qui leur permettent de se reconnecter à eux-mêmes.
Enfin, puisque l’objectif est de mettre les patients au cœur de la stratégie thérapeutique, leur parole est écoutée.
Ainsi, Maguy Delrio, avec son équipe, a livré un témoignage émouvant sur le vécu des patients au sein de l’ICM.
Aix-en-Provence : plus de 20 ans de succès !
Comme le rappelle le Dr Jean-Loup Mouysset, oncologue et fondateur du Centre Ressources d’Aix-en-Provence, c’est l’ensemble des soins apportés qui compte.
Il en sait quelque chose, lui qui a créé son institution en 2001, à une époque où personne ne parlait encore de médecine intégrative.
Il s’est formé auprès du Dr David Spiegel, un médecin américain qui a publié une première étude scientifique sur l’oncologie intégrative en 1989.
Dès le départ, l’objectif de cette approche est de traiter le cancer de manière globale en prenant en compte les dimensions physique, psychique, psychologique, sociale et familiale de la maladie pour le patient.
J’ai remarqué que Jean-Loup Mouysset cite des données très récentes ou plus anciennes.
Dès les années 2000 ou 2010, bien des études montraient déjà les bénéfices du sport, d’une alimentation de qualité ou de l’accompagnement du stress.
Durant toutes ces années de soins intégratifs, il a pu constater, au sein de son établissement, à quel point l’ensemble de ces approches — y compris la phytothérapie ou l’aromathérapie (présentée lors du congrès de Montpellier par le Dr Abdesselam Zhiri) — étaient bénéfiques pour les patients.
Un projet durable qui pourrait en inspirer d’autres
Aujourd’hui, le Centre Ressources fait figure de référence dans le domaine de l’oncologie.
Et le succès de l’expérience est tel que le projet se dote d’un nouveau lieu, plus grand et plus agréable, afin de pouvoir accueillir les patients et les proches les accompagnant.
Comme à l’ICM de Montpellier, les patients qui passent par ce centre reçoivent tous les soins classiques qui existent en oncologie à l’heure actuelle (chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie, chirurgie).
Les soins de support comptent une dizaine de thérapies, auxquelles s’ajoutent de nombreux ateliers proposés par les quelque 150 thérapeutes bénévoles associés au projet.
“Comment financez-vous tout cela ?” fuse une question dans la salle.
Jean-Loup Mouysset répond qu’il n’y a que 5 % de subventions.
Tout le reste vient de dons et de participations libres des patients.
Des entreprises locales peuvent apporter des financements en échange de séances de thérapie gratuites pour leurs salariés ; d’autres peuvent simplement faire des dons au nom de leur politique de RSE (Responsabilité sociétale des entreprises).
Bref, le projet est pérenne. Il est apprécié des soignants, des patients et de leurs proches.
C’est un exemple pour les différents centres d’oncologie intégrative qui sont en train de se monter ou de se consolider un peu partout en France.
L’ICM de Montpellier innove avec Miroki
À la fin du congrès, le Dr Julien Welmant a présenté le nouveau venu au sein de l’ICM : il s’agit du robot Miroki.
Je reviendrai plus en détail sur ce projet dans une lettre dédiée, parce que cela en vaut clairement la peine.
L’idée générale était d’apporter un accompagnement efficace et ludique aux enfants malades au sein de la salle de traitement en radiothérapie.
Ce robot, conçu avec l’aide d’une start-up française, Enchanted Tools, utilise l’intelligence artificielle et a été imaginé à partir des personnages de mangas japonais que les enfants apprécient. Il est tout jaune, avec des yeux immenses, et tout simplement craquant.
À l’Institut du Cancer de Montpellier, les machines aussi pratiquent la médecine intégrative.
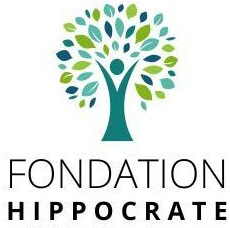

Excellent! Je suis ravie de savoir que la médecine intégrative entre à l’hôpital, et à l’ICM de Montpellier. Je suis passée à l’ICM de Montpellier pour des
séances de radio thérapie fin 2024. Et on ne m’a pas proposé de consulter ce service. J’ai trouvé le service de radio thérapie sympathique, accueillant, et ouvert. Mais je ne sais pas jusqu’où. Ils acceptent qu’on consulte un radiesthésiste ou quelqu’un qui coupe le feu. C’est déjà une grande ouverture. Votre article est une très bonne nouvelle.
Et en Belgique où en est on avec les nouvelles technologies ?
Oncologie intégrative…. n’est-pas là le synonyme de médecine holistique ?
R Caron, ancien IADE
Bcp d’espoir pour les patients pour une prise en charge humaine qui leur permet d’être » acteur » et partie prenante dans leur parcours médical.
Merci
Bonjour, avez-vous entendu parler de la Nouvelle Medecine Germanique du dr Hamer? c’est une approche allopathique très intéressante.
Bonjour, ont ils abordé la photobiomodulation dont plusieurs centres de cancérologie se sont saisis dans le cadre de la médecine intégrative ?
Bonjour. Merci pour ces bonnes nouvelles : Je suis traitée au CHU de Limoges depuis plus de 3 ans pour un myélome multiple. J’ai eu la chance d’être avec une équipe soignante ouverte, à l’écoute et qui a accepté mes demandes de « médecines douces ». j’ai ainsi pu bénéficier de séances de respiration, d’hypnose, de relaxation et même au premier inhalateur anti nausées mis au point par le tout jeune pôle aromathérapie. Personne ne s’est moqué de moi quand j’ai évoqué l’aide d’un barreur de feu et le miel pour palier les effets secondaire des séances de radiothérapie. C’est important d’avoir confiance en ceux qui nous prennent en charge lors de ces épreuves.
Merci encore.
Aline KREMEL